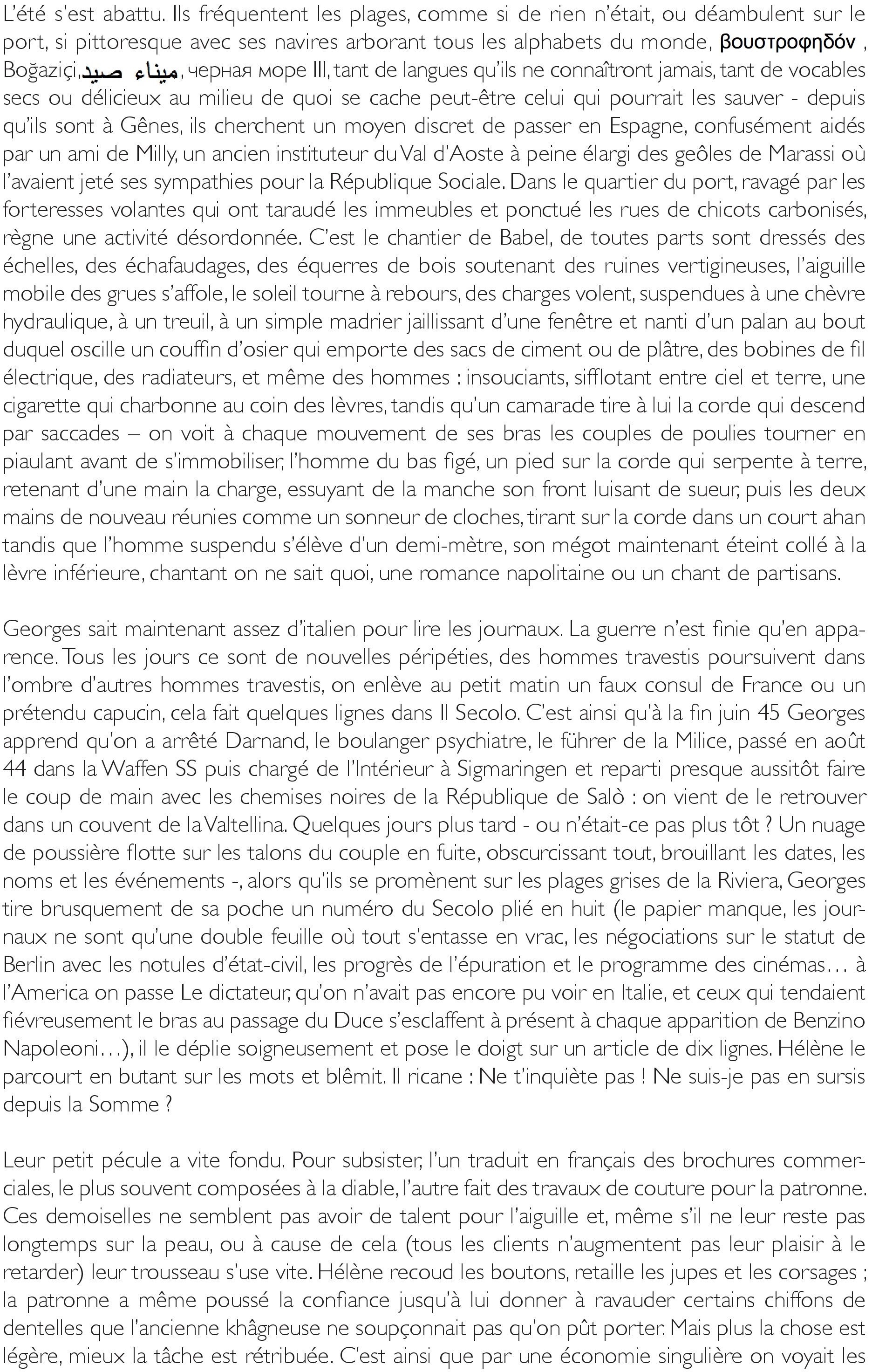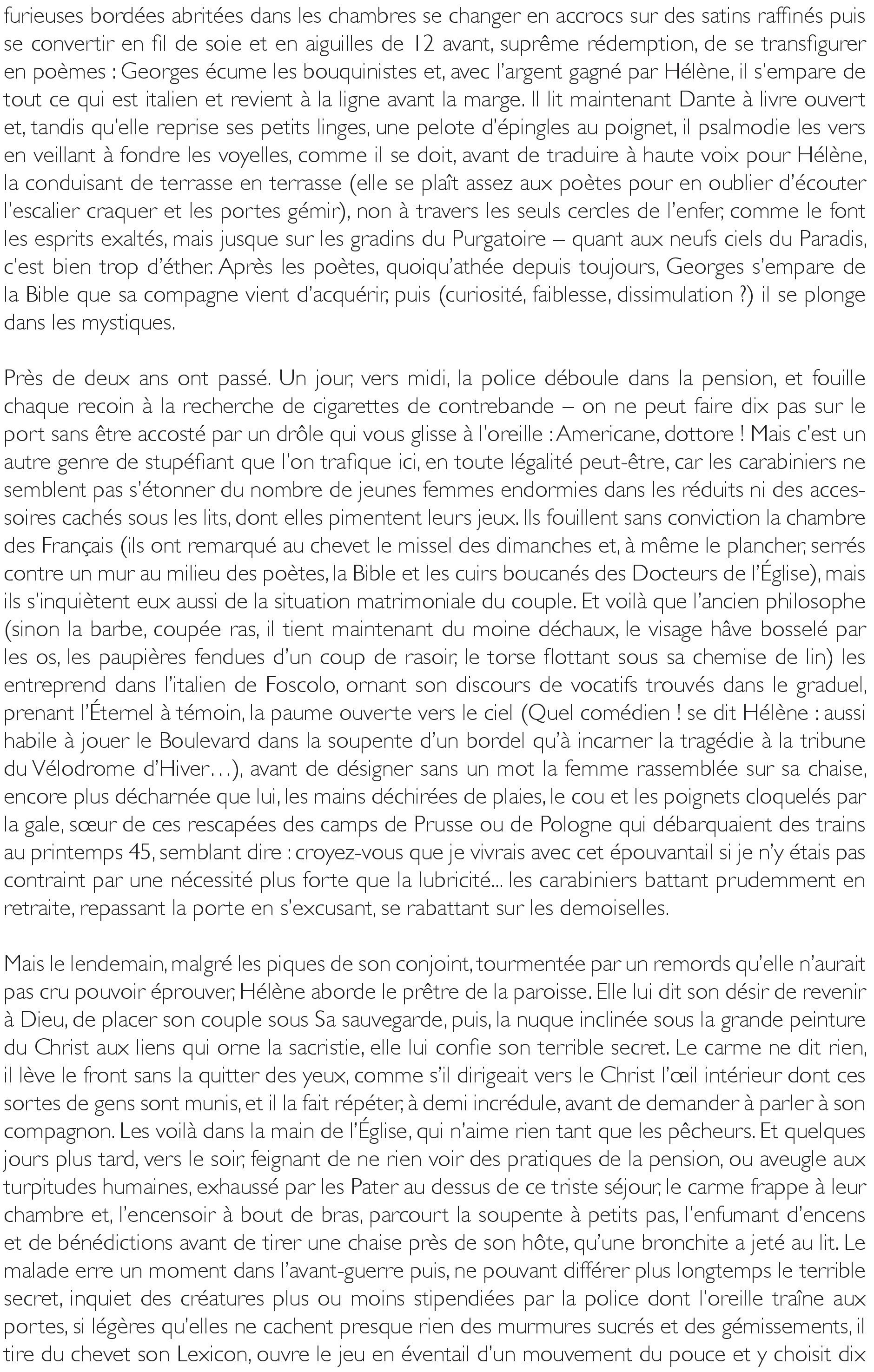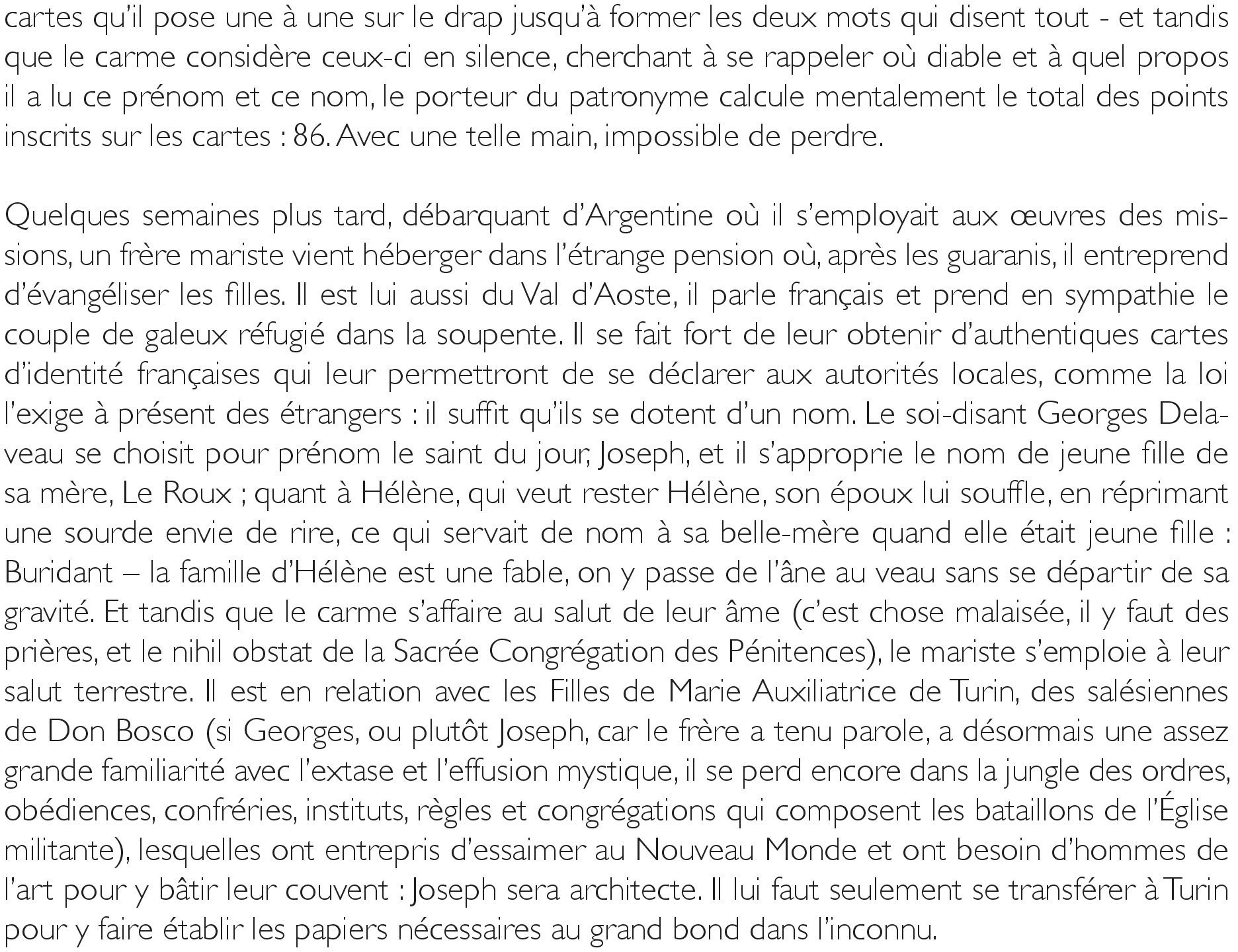incertain regard – N°19 – Hiver 2020 : Entretien avec Gérard Cartier
par Martine Gouaux
Gérard Cartier est né à Grenoble, en 1949, au pied du Vercors et de la Chartreuse, pôles autour desquels gravitent nombre de ses écrits. Il possède une solide formation scientifique. Sa vie professionnelle d’ingénieur est riche de voyages. Il a participé à la construction d’ouvrages importants : le tunnel sous la Manche, la ligne ferroviaire Lyon-Turin, les métros du Caire et d’Athènes… Vaste est également sa culture littéraire. Gérard Cartier est un poète reconnu, deux de ses livres ont été primés : Le Désert et le Monde (Flammarion, 1998), prix Tristan Tzara, et Méridien de Greenwich (Obsidiane, 2000), prix Max Jacob. Sa dernière publication est un roman, L’Oca nera (La Thébaïde), sorti en 20191. Je ne peux clore cette présentation sans mentionner son implication dans l’organisation, avec Francis Combes, de l’affichage de poèmes dans le métro parisien entre 1993 et 2007, son activité de critique de poésie et de coordinateur de la revue littéraire en ligne Secousse.
Nous nous rencontrons à la bibliothèque d’Achères où l’on met à notre disposition la pièce qui, cette année, sert d’atelier à un écrivain, Gérard Noiret, et à un artiste, Frédéric Cubas-Glaser. C’est entourés de leurs œuvres, accrochées aux murs et en chantier, que nous nous installons.
D’où vient ce besoin de poèmes ? Y a-t-il des auteurs ou des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont orienté vers la poésie ?
C’est une bonne question : pourquoi écrire ? et pourquoi de la poésie plutôt que de la prose ? Je n’ai pas de réponse, c’est le fruit d’une pulsion irraisonnée. J’ai été attiré assez tôt par la poésie. Adolescent, j’écoutais une émission de radio qui s’appelait « le Club des poètes » – il me semble que c’était le dimanche soir, sur le France Inter des années 1960. Les poèmes étaient lus par des comédiens, il y avait parfois des moments extraordinaires. Je me souviens encore, par exemple, d’un poème de Baudelaire lu par Wicky Messica : « Ma femme est morte, je suis libre ! / Je puis donc boire tout mon saoul… »
Les poètes qui m’ont marqué sont très variés. Mes premières vraies émotions sont dues à Baudelaire (j’ai longtemps porté sur moi Les Fleurs du mal) et à Verlaine ; un peu plus tard, à Apollinaire et à Cendrars. J’ai ensuite découvert les surréalistes, qui m’ont beaucoup occupé, même si je n’ai jamais écrit dans cette veine. Puis j’ai descendu le fleuve de la poésie, avec les poètes de l’après-guerre (parmi lesquels Yves Bonnefoy et Jean Malrieu), jusqu’aux contemporains. Parmi ceux-ci, certains m’ont marqué durablement : Paul Louis Rossi, découvert avec Le Voyage de Sainte Ursule, Jean Ristat, Franck Venaille et quelques autres. Ce sont des poètes aux écritures extrêmement différentes, parfois aux antipodes les unes des autres. Mon parcours de lecture est donc banal, mais il a sa justification. On ne peut pas écrire sans avoir en tête l’histoire de la poésie, sans lire les autres, les grands anciens comme les contemporains, sans se confronter à eux : on écrit souvent en réaction à la génération qui précède. Ce qui ne dispense pas, évidemment, de travailler beaucoup…
J’ai relevé une phrase, au tout début de L’Oca nera, qui peut être une sorte de chapeau à quelques questions que je souhaitais vous poser : « Toute expérience (la lecture d’un livre au même titre que l’étude de l’Histoire ou l’épreuve de la vie) est un affrontement à la complexité ; elle ne vaut que pour autant qu’on en dégage soi-même le sens. » Pouvez-vous nous parler du hasard et de la recherche de sens ? Le hasard est un thème qui revient souvent chez vous, qui est d’ailleurs le titre d’un de vos recueils (Obsidiane, 2004).
Le hasard est en effet pour moi un thème important ; il est le lieu et la condition de la liberté d’écriture. Dans L’Oca nera, par exemple, je me suis donné au départ une contrainte assez forte, puisque la structure du livre est celle d’un jeu de l’oie. Il est composé de 62 chapitres, comme autant de cases ; on y trouve à leur place habituelle les cases néfastes (l’hôtel, le labyrinthe, la prison, la mort, etc.) et, de neuf en neuf, un chapitre dévolu à l’oie (qui est ici noire, comme l’indique le titre) ; s’y ajoute un dernier chapitre, le « paradis » de l’oie, comme dans le jeu. Le récit lui-même épouse la géométrie du jeu, puisqu’il se développe en spirale en se resserrant peu à peu sur l’énigme – la figure de la spirale y apparaît d’ailleurs de façon récurrente. L’intrigue, à l’intérieur de ce cadre assez strict, c’est le hasard qui l’a déterminée – comme dans la vie : le jeu de l’oie a de tous temps été réputé une image de la vie humaine. Paradoxalement, ce jeu de la contrainte et du hasard donne une grande liberté pour inventer, pour réagir aux sollicitations de l’imagination.
Je vais vous donner un exemple. Hormis la forme générale du livre, l’identité du narrateur et celle de « l’oie noire » (que j’avais en tête depuis des dizaines d’années), je n’avais aucune idée précise des thèmes que j’embrasserais. C’est en écrivant que les autres personnages sont apparus, en particulier Mireille Provence. Elle a une existence historique, on la connaît sous le surnom de « l’espionne du Vercors ». J’en avais entendu parler par mon père. Vivant dans cette région après la guerre, il était impossible de ne pas être marqué par le drame du Vercors. En outre, l’un de mes oncles y a été fusillé. Nos mémoires ne sont pas seulement individuelles, elles charrient aussi une partie des émotions et des savoirs de ceux qui nous ont précédés. Pour en revenir à Mireille Provence, elle ne faisait pas initialement partie du livre. Elle y est apparue de façon naturelle, appelée par le thème du Vercors, et est devenue peu à peu si nécessaire que j’ai fini par enquêter sur elle – une véritable enquête, dans les archives. Elle s’est imposée d’autant mieux qu’elle fait contrepoint au personnage de l’oie noire.
Cette méthode de composition est aussi celle de mes livres de poésie. Je ne vais jamais totalement à l’aventure ; je définis toujours un plan au préalable ; mais, à l’intérieur de cette contrainte, je procède avec la plus grande liberté.
L’Histoire, la géographie, sont également des thèmes importants dans ce que vous écrivez. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez écrit Alecto (Obsidiane, 1994), recueil qui m’a profondément touchée ? Avez-vous fait le voyage à Terezìn ?
Alecto est un tombeau de Robert Desnos. Il a été déporté en Allemagne et, après être passé de camp en camp, est mort à Terezìn, en Tchécoslovaquie, peu après la Libération. Le lieu est évidemment important. Je suis allé en Tchécoslovaquie mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, pour garder ma liberté de création, je n’ai pas pris la route qui menait à Terezìn alors que je n’en étais qu’à quelques kilomètres. J’ai évidemment beaucoup fréquenté Terezìn par la pensée et par les livres. Mais plus que la géographie, ce qui est important dans Alecto, c’est l’Histoire, celle de la seconde guerre mondiale.
Beaucoup de mes livres s’inscrivent dans le siècle. La résistance en Vercors était déjà le thème d’Introduction au désert (Obsidiane, 1996) et du Désert et le monde. Certaines pages du Hasard traitent de la guerre d’Algérie et de la Palestine. L’Histoire est une inquiétude, de nature presque politique. On ne peut pas vivre sans nouer des rapports avec ce qui nous a précédé : le passé nous aide à penser le présent. C’est aussi la leçon de L’Oca nera, avec ce double jeu, ce balancement entre la résistance armée dans le Vercors contre l’oppression nazie et le mime qu’en font aujourd’hui dans le Val de Suse les opposants au projet Lyon-Turin…
Quant à la géographie, elle est pour moi essentielle. Tous mes livres sont situés, ils empruntent à des lieux précis. On peut même considérer que L’Oca nera est le roman d’un territoire : celui que cartographie le plan 77 de Michelin… Il en est de même de mes livres de poésie. L’histoire naturelle y occupe aussi une grande place. En fait, j’écris des livres pour l’école primaire : l’Histoire, la géographie, l’histoire naturelle, la morale, les mathématiques !…
Au sujet de la ponctuation, vous citez Octavio Paz au tout début des Métamorphoses (Le Castor Astral, 2017) : «La poésie est nombre, proportion, mesure : langage – sauf qu’elle est un langage tourné sur soi et qui se dévore et qui s’abolit pour qu’apparaisse l’autre, le démesuré, le soubassement vertigineux, le fondement abyssal de la mesure.» Que devient la ponctuation dans vos poèmes ?
Cela revient à poser la question de ce qu’est la poésie par rapport à la prose car, pour moi, il n’y a pas de poésie s’il n’y a pas un travail sur la mesure, le rythme. Dans la prose, ce qui mesure l’expression, et aussi la pensée, c’est la ponctuation. En poésie, on peut user d’autres moyens que le point et la virgule – c’est mon cas.
Gérard Cartier poursuit en explicitant le rôle dans sa poésie des espaces blancs ou des majuscules (petits silences internes aux vers) : autant d’aides au sens et façons de mesurer, de rythmer le poème.
Le poème est chant, rythme, sonorités. Le sens n’est pas premier, il y est pris, il en résulte ; il n’est donc pas forcément linéaire. Dans les vers, la rupture en bout de ligne, outre un rôle de mesure, est une façon de briser le cours de la pensée : elle est propice à la surprise, au changement d’idée. Vis-à-vis du sens, le poème a un statut ambigu. Il faut que le lecteur comprenne, bien sûr, mais il est bon de ménager une certaine incertitude, voire une duplicité, un double sens. Quand tout est parfaitement transparent, linéaire, sur le modèle de la prose, cela fait rarement une bonne poésie. Le jeu du sens, du clair et de l’obscur, est l’un des plaisirs du poème – ainsi, quand je lis Sophie Loizeau par exemple…
La construction de vos livres, poésie ou roman, est primordiale. Je pense, par exemple, aux Métamorphoses et au Voyage de Bougainville (L’Amourier, 2015). Les tables et index invitent à un jeu, ce sont des propositions d’entrée dans les poèmes, autant de perspectives de lectures différentes pour un même poème.
Oui, et il y a là un aspect ludique. Je ne publie pas de recueil, c’est-à-dire de collection de poèmes écrits au fil des jours, pour noter une émotion fugitive, une réflexion, une scène, etc. Je ne commence jamais un livre sans en définir auparavant la forme globale : elle préexiste à l’écriture. Il en est ainsi du Voyage de Bougainville, de L’ultime Thulé (Flammarion, 2018), qui imagine le voyage de Saint Brendan (lui aussi en forme de jeu de l’oie), etc. Chaque poème a évidemment une signification en soi, mais il ne prend son sens véritable qu’au sein de l’ensemble. Les tables des matières explicitent la structure du livre, dont on n’avait pas eu forcément conscience à la lecture. Par exemple, c’est en lisant la table des Métamorphoses qu’on se rend compte que chaque poème évoque un auteur et un élément d’un banquet (un plat, un dessert, un vin) et que l’ensemble forme un art poétique. C’est bien sûr un jeu.
Dans le dernier poème de votre livre Le hasard, vous écrivez :
« …je compte et corrige
Lente rédemption Et avant que se répande
Le silence je recompose le monde
Découpant dans la matière du hasard
Un sens plus parfait… »
Où se trouve le je ? Se trouve-t-il, comme vous le dites, dans le « je compte et corrige »? Recomposition du monde et création de soi semblent intimement liés ?
Dans cette citation, que j’avais oubliée, il me semble qu’il y a une chose importante : c’est que le monde est une invention. On le bâtit en soi, en tâtonnant – ce n’est pas une pensée fulgurante. J’écris rarement sous le coup de l’inspiration. Je sais généralement que je vais écrire un poème sur un thème donné, parce que j’ai un trou dans mon livre. Je fais un premier jet ; ce qui vient est décousu, le sens profond manque. C’est en reprenant cette ébauche, en la travaillant, que le sens peu à peu se forme, naît du poème, qu’un accord se fait entre les mots et le sens – qui n’est pas forcément explicité, qui peut rester sous-jacent. Je crois que pour le monde, c’est-à-dire la société, l’Histoire, la géographie, etc. c’est un peu pareil : son sens ne se donne qu’en tâtonnant. C’est pourquoi on le comprend souvent mieux à travers des œuvres littéraires, romans ou poèmes. La littérature joue un rôle essentiel pour façonner la vision qu’on se fait de la réalité.
Pendant que je préparais cet entretien, j’ai entendu par hasard à la radio une personne invitée qui citait une phrase de Marcel Proust : « Les idées sont des succédanés des chagrins », et bien sûr, je me suis demandé si c’était aussi vrai pour vous ?
Je ne crois pas que cela ait beaucoup joué pour moi. Si je considère ce que j’ai écrit depuis l’origine, ce n’est pas le chagrin qui a été déterminant : ce serait plutôt une émotion, souvent aveugle (le chagrin étant une émotion aveugle, on peut penser que c’est un cas particulier d’une loi plus générale…), une émotion qui n’avait pas trouvé forme et qui s’est logée dans un objet littéraire, beaucoup plus stable. Mais je crois qu’il n’y a pas que cela, qu’il n’y a pas que l’émotion : il y a aussi le jeu, on en a parlé ; il ne relève pas du chagrin, c’est autre chose.
Je lisais récemment un recueil de Paol Keineg, où l’auteur manifeste un grand désenchantement : lequel vient de l’âge, certainement, mais qui est aussi dû à l’évolution du monde, à la perte des idéaux, à ce qu’il appelle « le déclin du matérialisme historique ». C’est une émotion, mais d’une tout autre nature que celle qu’on peut éprouver à la perte d’un être cher, lors d’une rupture sentimentale, ou d’une grave maladie.
Ma dernière question concerne votre participation à l’élaboration de livres pauvres à la bibliothèque d’Achères. Que retirez-vous de cette expérience ?
C’est un défi. On doit écrire, en quatre heures, quatre poèmes en réaction au travail graphique ou pictural des artistes invités, sans avoir rien préparé (c’est au moins mon cas). C’est une contrainte, un jeu. On est amené à aller sur des terrains qui nous sont étrangers, tant au niveau des thèmes que des formes. Les poèmes sont plus ou moins réussis, mais je reviens chaque année avec un grand plaisir. Je trouve toujours moyen de réutiliser ces poèmes. Je n’aime pas qu’ils traînent dans la nature : il faut qu’ils s’insèrent dans l’un ou l’autre des livres en cours.
Gérard Cartier développe ensuite quelques techniques d’écriture : la réutilisation, dans un autre ouvrage, moyennant des ajustements mineurs, de poèmes qui « s’échappent » du livre en cours d’écriture (il explique que Le voyage de Bougainvilleest ainsi né d’une série de poèmes initialement écrits pour L’ultime Thulé) ; ou la reprise sous une autre forme d’un poème « qui ne prend pas », par exemple par la mise en prose d’un poème initialement écrit en vers, ou le contraire.
En le réécrivant sous une autre forme, on retrouve une liberté qui permet de le mener à bien, de lui donner sens. Ce qui veut dire aussi (mais on le sait depuis longtemps) qu’un poème n’a de sens que lorsqu’on l’a écrit. Il est réussi quand la forme et le sens se nouent.
Y a-t-il des questions, des thèmes que je n’ai pas abordés et qui manqueraient ?
On me demande souvent comment on peut être à la fois poète et ingénieur [rires], et aussi quel est mon rapport à la religion. Je suis athée, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse croire en un dieu, mais je suis fasciné par la posture monastique. Étant jeune (10-13 ans), j’ai passé plusieurs étés dans une colonie de vacances située dans un ancien monastère, au milieu de la Chartreuse, un lieu extraordinaire. C’est l’âge où l’on amasse quantité d’images qui resteront à vie. Cela m’a marqué profondément : les forêts sauvages, la montagne, le ciel et les étoiles, et parfois, au fond des forêts, une ombre blanche qui passait : un chartreux… L’attitude du moine est une métaphore parfaite de celle de l’écrivain. Chaque écrivain se fait une représentation de lui-même, une sorte d’image élémentaire autour de laquelle il gravite en permanence, qu’il glisse de temps en temps dans ses pages, et à partir de laquelle il parle. L’écrivain est pour moi un être reclus dans la solitude et le silence, qui marmonne des choses qui lui sont essentielles, mais qui n’ont évidemment aucune espèce d’importance : un moine. Il y a peut-être autre chose, que je ne sais pas expliquer : l’attrait de la solitude, le fait de vivre avec presque rien, quelques livres, et la nature autour. S’y greffe un autre mythe, celui de Robinson : recréer le monde à partir de rien. C’est une image fascinante (c’est peut-être l’ingénieur qui parle !) : parcourir en raccourci toute l’histoire de l’humanité…
Nous poursuivons avec le pouvoir qu’ont certaines images : « …leur éclat cache un monde occulte, un noyau aveugle où dorment nos passions, si dense qu’il rayonne sans lumière et nous happe malgré nous. » (L’Oca nera, p. 49). Gérard Cartier évoque à ce propos la photo de Mireille Provence, sa « sidération » quand il l’a découverte dans les archives, la façon dont cette image est venue casser le mythe, compliquant la représentation du personnage : un retour à l’idée « d’affrontement à la complexité », évoquée en début de rencontre…
Et l’entretien s’achève comme un ricochet qui, naturellement, mettrait un point final à la courbe.
1 Depuis cet entretien, est paru Du franglais au volapük : ou le perroquet aztèque, éditions Obsidiane, 2019 [NDLR]
incertain regard – N°19 – Hiver 2020 : Les enfances de Mara : Extrait de Le roman de Mara, à paraître
.I.
Mara dans les neiges exposée au Vercors
frissonnant en langes dans sa tour d’abandon
chauve laiteuse la voix accordée aux viscères
Mara en cornette enfantée d’une morte
babillant insatiable alphabet de voyelles
les yeux fendus de fièvre masque mongol
trébuchant funambule chasse aux araignées
des idéogrammes sur des papiers fripés
Mara au-dessus des jardins un bouquet
d’orties entre les dents rien ne peut nous atteindre
ces images confuses que le vent va mêler
et rendre au hasard tracées dans la poussière
du bout d’un bâton ces mots d’une langue
à jamais perdue s’agit-il de faire œuvre
de vérité d’être soi en dépit
du mensonge où il faut pourtant se cacher
.II.
Perdu dans les neiges de Lans chancelant
Mara sur les épaules plus de traces
cherchant le chemin du refuge les yeux
fixés sur une faible étoile pieds
et mains brûlés jetés hors du temps
les glaces arctiques désert de vent
68 degrés Nord
une pie sur la neige
irritée tchac-tchac-tchac et dans la brume
une lune bossuée qui attend
patiemment notre défaite
hiberner ici
au milieu des grands sapins tremblants
solitaire la barbe et la manche givrées
un abri de terre au toit de mousse un lit
de fougères une enfant dans les bras
et l’amitié des bêtes rousses
vivant de rien
un trou dans la glace dans les buissons
des lacets taciturne enseigné
par un maître prodigue la nécessité
.IV.
L’orage gronde pur délice le fleuve gonfle entre les toits
moite été sous le plomb demi-nu une enfant dans
les bras entre deux abîmes les yeux levés semblable
aux premiers hommes Viens d’en-haut tout droit…
des mots mal équarris prière au dieu un silex entre les
dents que le feu me purifie qu’il chasse l’esprit
mort qui m’habite entre en moi Huecuve…
La foudre court docile à la voix fend le premier ciel
flèche oblique l’eau goutte sous les rameaux tressés
l’argile rougit je chante à la terrasse visage
ruisselant pure jouissance une enfant dans les bras
qui chasse à main nue le feu volant Détruis moi
Huecuve… lézard vif-argent pour elle que rien
n’asservit redevenir sauvage lave-moi… et renaître
un autre
.VII.
J’entamerai ce soir mon poème par A
afin qu’y résonne au premier coup de gong
le nom de Mara dessinant face au ciel
les monts de Belledonne MMM
qui s’aiguisent au fond des rues vaporeuses
un autre coup de gong puis un râle
A bossu MARA la main souillée d’encre
tâtant d’un bâton tremblant le papier
toutes les lettres pas à pas tous les êtres
PAPA ce monstre androgyne BABAR
le roi apoplectique et tous les mystères
entortillés de l’orthographe et des fils
en nerf de loup de Jack London aux aiguilles
de Phileas Fogg jusqu’à copier un jour
dans un carnet de soie Me voici donc seule
sur la terre ou dans un sanglot
sa beauté me rend malade MALAAAA
jetant de rage son crayon comme hier
avec les haillons d’un poème rebelle
elle m’a vu faire
.XII.
Au jardin ce matin Histoire Naturelle
HÉRISSON mort longues dents nez pointu
air de grand-mère sous son châle incommode
comment tombé là enfui des Ursulines
lassé de l’ascèse et du latin eri
naceus qu’en dit l’Ancien au désespoir
ils rendent sur eux une urine nocive
et Buffon si mauvaise humeur si fâché
d’être en prison l’œil irascible pas touche
Mara épineux et grouillant de vermine
ici sous nos murs sera son au-delà
un trou sous un buisson d’épine-vinette
mais la nuit suivante étrange et prolifique
chacun est cinéaste dans le secret des rêves
il se glisse dans son lit et la couvre
d’urine cri déchirant l’arracher au porte
épines titubante d’effroi de sommeil
vite une douche et laver ses draps
infestés de vermine
.XV.
Une comète pâle tout un hiver
a balayé le nord sa longue traîne
déployée sur la Chartreuse apportant
aux uns l’espérance aux autres l’affliction
et nous voilà cette nuit plantés sur la terrasse
l’araignée entre les dents sondant à la lunette
les parages d’Andromède où tout à coup
une lune tachetée monte en oscillant
guarda ! globe de cendre et de papier mâché
qui court sous la molette dans le noir transi
les poètes Mara l’ont prétendu un monde
semblable à celui-ci des mers tempétueuses
et des monts abrupts où perdus dans les neiges
les Sélénites vont en chancelant qui regardent
monter dans leur ciel les étoiles lointaines
en raisonnant de la pluralité des mondes
ou bien ayant comme ici jeté au bûcher
les philosophes ils implorent des dieux
exilés sur la Terre mieux là-haut
comme ici charme le ciel des fables
que l’astronomie
.XVI.
Scène de genre les parapluies tanguent
les passants zigzaguent courbés sous le fouet
de la bourrasque elle accourt
le long des quais sous les tilleuls froissés
fille de l’averse et du vent nomade comme
surgie des eaux née d’une époque ingénue
où l’on broyait le myrte le cèdre et le roseau
pour convier à sa table en esprit
des dieux gourmands comme des mouches
où parfois sous les pieds le serpent qui fuyait
ou la génisse dans la lande ou le geai
était un ministre des hiérarchies
et comment à présent reculer
au bord d’un fleuve entre les joncs sauvages
demie nue sous le voile humide qui la cache
et la révèle s’offrait au passant égaré
une nymphe au front ruisselant ainsi
sur les quais de l’Isère renouvelant
la promesse qui avait failli Mara
dessinée par l’averse
.XX.
Mara au jardin mais où sa voix fluette
perdue entre ville et montagne où
est donc Ornicar légère à l’égal
des simples créatures les pies en haut
en bas les limaçons scandant la grammaire
qui que quoi dont où au milieu de qui
vit dans l’instant latin méthodique
à rendre raison du hasard des mots qui sait
si ne va pas tout à coup se coucher
un monstre à ses pieds sorti de l’abîme
qu’aura envoûté ce concert de voyelles
comme autrefois quand les bêtes parlaient
en strophes mesurées et que le destin
se pliait à nos rites jetant à volonté
la mort à l’improviste ou la passion les mots
ingrats qui ne gouvernaient plus le monde
à nouveau gonflés de secrets abaco
soutra vanviem pourquoi
sinon gronderait le ciel les Ursulines
vont sortir de leur tombe et tout renaîtra
neuf et clair comme avant le déluge Adam
part pour Anvers avec cent sous…
incertain regard – N° 12 – Mai 2016 : Le bordel : Extrait de L’Oca nera, roman en cours d’écriture
La patronne de la pension est courte, épaisse, c’est une sorte de Milly Mathis évadée de Zurich et teinte à la bière. Sans doute a-t-elle deviné la situation délicate du couple (elle les dévisage en plissant les yeux avant de se racler la gorge d’un pitoyable : Dieses arm Deutschland…) car elle accepte sans rechigner les cartes de reconnaissance qu’Hélène a négociées à Milan quinze jours auparavant.